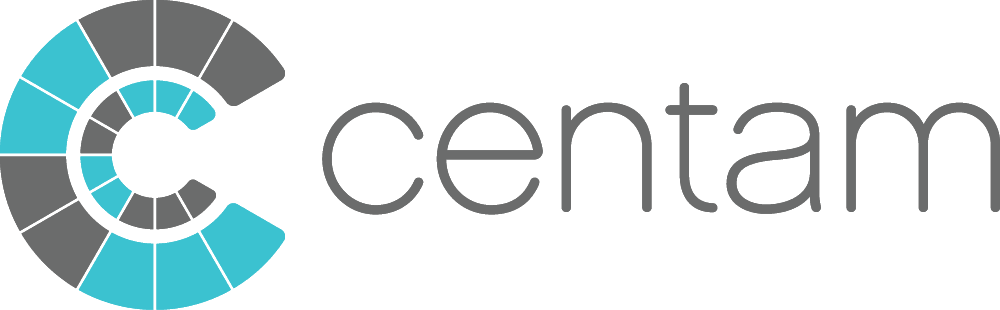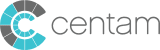La dysphasie
Table des matières
La dysphasie : trouble développemental du langage et de la communication
Le trouble développemental du langage (TDL), ou dysphasie, est un syndrome d’origine neurologique présent dès la petite enfance. Le trouble développemental du langage perturbe les habiletés de communication verbale, notamment la compréhension du message véhiculé dans le discours ou l’expression verbale de la pensée.
La dysphasie est causée par un dysfonctionnement des structures cérébrales impliquées dans le langage (localisées, pour la plupart des humains, dans l’hémisphère gauche), ainsi que des régions avoisinantes responsables de fonctions non langagières. Ainsi, bien qu’un trouble spécifique du langage soit l’une des composantes principales, la dysphasie regroupe également d’autres déficits neuropsychologiques, touchant notamment :
- l’attention ;
- la mémoire ;
- la planification et l’organisation ;
- la motricité fine et globale.
La dysphasie et ses causes
Le trouble développemental du langage est un trouble d’apprentissage permanent qui n’est ni causé par ni relié à :
- Un trouble sensoriel : Le trouble d’expression orale ou de compréhension n’est pas provoqué par un problème auditif ni visuel.
- Une déficience intellectuelle : Bien que les habiletés de communication soient perturbées chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, les fonctions intellectuelles globales (raisonnement, abstraction, etc.) sont préservées chez les personnes dysphasiques. La communication non verbale est également intacte.
- Une malformation des organes de production des sons : Dans la majorité des cas, les organes phonatoires (bouche, larynx, langue, etc.) fonctionnent normalement.
- Un trouble du spectre de l’autisme : Contrairement à l’autisme, la dysphasie n’est pas associée à une rigidité intellectuelle, à des intérêts restreints ou à des comportements stéréotypés.
- Un manque de stimulation : Bien qu’un manque de stimulation puisse entraîner un retard temporaire dans le développement du langage, ce retard est rattrapable avec un programme de rééducation spécialisé. En revanche, la dysphasie est un trouble permanent, où le fonctionnement langagier est non seulement immature, mais également anormal.
- Un trouble psychoaffectif : La dysphasie n’a pas une origine affective ou psychologique. Toutefois, la difficulté à se faire comprendre et à exprimer ses besoins ou sentiments peut entraîner des frustrations et des comportements agressifs. Ces derniers doivent être perçus comme des symptômes et non comme des causes.
Une ou des dysphasies ?
La gravité du trouble et la nature des troubles associés varient considérablement d’une personne à l’autre. Il n’existe donc pas une seule dysphasie, mais plutôt plusieurs formes. Trois facteurs influencent les caractéristiques du trouble :
a) les composantes du langage touchées ;
b) l’âge de l’individu ;
c) les autres déficits neuropsychologiques associés.
Le langage est composé de plusieurs sous-systèmes qui peuvent être affectés indépendamment :
- Phonologie : perception, manipulation et organisation des sons formant les mots ;
- Lexique : accès au vocabulaire et au mot juste ;
- Syntaxe : organisation des mots pour former des phrases cohérentes ;
- Morphologie : connaissance des règles de combinaison des mots (préfixes, suffixes, etc.) ;
- Sémantique : compréhension du sens des mots et des phrases ;
- Pragmatique : liens entre le langage et son contexte d’utilisation.
Les capacités langagières évoluent à des rythmes différents selon les étapes du développement. Ainsi, une dysphasie légère à 5 ans peut s’aggraver à 12 ans, ou inversement.
Troubles neuropsychologiques associés
En plus des atteintes langagières, la dysphasie s’accompagne souvent d’autres déficits, tels que :
- l’attention ;
- la mémoire (court terme, de travail, long terme) ;
- la pensée verbale et la conceptualisation ;
- les fonctions exécutives (gestion mentale, planification, organisation) ;
- l’organisation temporelle et la perception du temps ;
- l’orientation spatiale et les habiletés visuo-spatiales ;
- la motricité fine et globale ;
- les troubles d’apprentissage spécifiques, comme la dyslexie, la dysorthographie ou la dyscalculie.
Les différents types de dysphasie et leurs impacts sur l’apprentissage
Les critères diagnostiques des manuels médicaux (DSM-5-TR, ICD-11) identifient trois grandes catégories de dysphasie :
- Dysphasie expressive : La production et l’élaboration du discours sont perturbées. Les paroles peuvent être indistinctes, les phrases mal construites, ou encore le discours vide de sens. L’étudiant peut bien comprendre l’information mais avoir du mal à l’exprimer.
- Dysphasie réceptive : La compréhension du langage est affectée, entraînant des réponses hors sujet et une baisse de motivation.
- Dysphasie mixte : L’expression et la compréhension sont altérées.
Estime de soi et socialisation
Les enfants dysphasiques peuvent éprouver une grande frustration à cause de leurs difficultés de communication, ce qui peut mener à des jugements, à des rejets par leurs pairs et à une tendance à l’isolement. Une intervention sociale est donc essentielle pour favoriser leur intégration.
L’évaluation
L’identification formelle de la dysphasie est un processus différentiel. Le neuropsychologue fera une évaluation complète qui tient compte de l’ensemble des fonctions neuropsychologiques (comme les compétences intellectuelles, la mémoire, l’attention, les habiletés motrices, l’organisation et la planification, les habiletés visuo-perceptives), du profil psychoaffectif (les traits anxieux et dépressifs, l’estime de soi, les comportements d’oppositions et agressifs, la socialisation) et des habiletés de communication verbale (la saisie du message et la compréhension, la production et l’élaboration du discours et des idées).
L’évaluation en neuropsychologie permettra donc de distinguer un trouble d’apprentissage qui relève de la dysphasie d’autres troubles qui peuvent directement ou indirectement affecter les habiletés de communication langagière mais qui n’ont aucun lien avec la dysphasie. Par exemple, les enfants qui souffrent d’autisme, de déficience intellectuelle légère, de mutisme sélectif, de trouble de la mémoire et de déficit grave de l’attention peuvent tous avoir des manifestations langagières qui ressemblent grandement à celles que l’on retrouve chez les enfants atteints de dysphasie. En outre, une évaluation complète de l’ensemble des fonctions neuropsychologiques (incluant le profil psychoaffectif et le rendement académique) est importante en ce qu’elle permet également d’identifier les troubles qui coexistent avec la dysphasie. En effet, plusieurs enfants aux prises avec une dysphasie peuvent également présenter des troubles de mémoire verbale, d’attention, de motricité ainsi que des troubles de planification et d’organisation. Finalement, l’évaluation de l’ensemble des fonctions neuropsychologiques de l’enfant permettra aussi de faire ressortir ses forces. Il ne faut surtout pas oublier que l’avenir de ces individus passe souvent par leurs intérêts et leurs forces.
Ainsi, l’identification formelle de la dysphasie repose sur une évaluation neuropsychologique complète. Celle-ci examine :
- les fonctions neuropsychologiques (compétences intellectuelles, mémoire, attention, habiletés motrices, etc.) ;
- le profil psychoaffectif (anxiété, estime de soi, comportements agressifs ou opposants) ;
- les habiletés de communication verbale (compréhension, production, élaboration du discours).
Cette évaluation permet de distinguer la dysphasie d’autres troubles (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, troubles psychoaffectifs) et d’identifier les troubles associés. Elle met également en lumière les forces de l’enfant, essentielles pour son développement et sa réussite future.