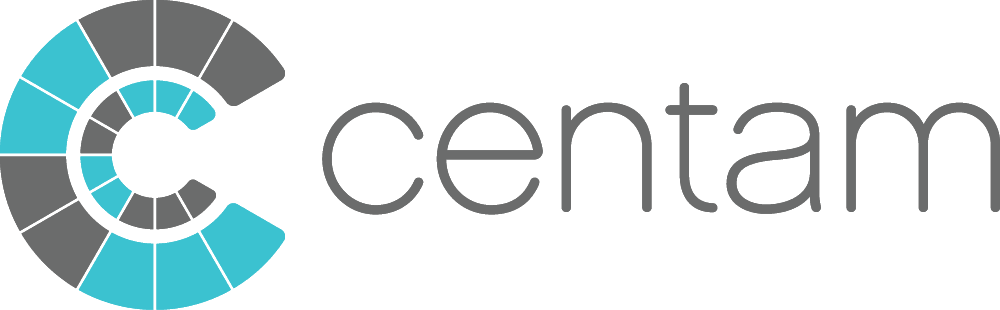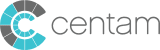La commotion cérébrale
Table des matières
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?
Une commotion cérébrale, ou traumatisme craniocérébral léger (TCCL), est une perturbation du fonctionnement cérébral causée par un choc ou une secousse à la tête, ou par une force impulsive exercée sur le corps et transmise à la tête. Contrairement aux traumatismes crâniens graves, elle n’entraîne généralement pas de lésions visibles sur les examens standards d’imagerie comme le scanner ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Cependant, des techniques avancées, souvent utilisées dans le cadre de la recherche, ont permis de détecter des anomalies fonctionnelles et microstructurales du cerveau après une commotion cérébrale.
Les forces physiques à l’origine d’un TCCL résultent d’un mouvement rapide et soudain de la tête, suffisamment intense pour provoquer un déplacement brusque du cerveau à l’intérieur du crâne. Ce déplacement peut entraîner des impacts contre les parois crâniennes, causant des microtraumatismes (Meaney et al., 2011).
Causes fréquentes
Les commotions cérébrales peuvent survenir dans divers contextes :
- Sports de contact : soccer, football, hockey, équitation, cheerleading.
- Chutes.
- Accidents de la route.
- Secousses importantes, même sans impact direct à la tête.
Symptômes courants
Les symptômes d’une commotion cérébrale peuvent apparaître immédiatement, plusieurs heures et même jusqu’à 24 heurs après l’impact. Ils incluent :
- Physiques : maux de tête, nausées, vertiges, troubles de la vision, sensibilité à la lumière ou au bruit.
- Cognitifs : troubles de concentration, confusion, perte de mémoire.
- Émotionnels : irritabilité, anxiété, dépression.
- Sommeil : insomnie ou somnolence excessive.
Certains symptômes, comme une perte de conscience prolongée, des vomissements répétés ou une somnolence extrême, nécessitent une consultation médicale immédiate.
Diagnostic
Le diagnostic repose principalement sur l’évaluation clinique. Les examens d’imagerie standard, bien qu’ils permettent d’écarter des lésions graves, ne révèlent souvent rien en cas de commotion cérébrale. Des outils spécifiques, comme des questionnaires et des tests neuropsychologiques, peuvent aider à évaluer l’impact cognitif.
Récupération et gestion
La plupart des individus récupèrent complètement en quelques jours ou semaines. La prise en charge comprend :
- Repos physique et cognitif : limiter les activités sollicitant le cerveau ou le corps pour quelques jours.
- Retour progressif aux activités : reprendre graduellement les activités scolaires, professionnelles ou sportives sous supervision médicale.
- Consultation spécialisée : en cas de symptômes persistants, une évaluation médicale ou par une équipe multidisciplinaire est recommandée.
Le syndrome post-commotionnel
Selon le rapport du Task Force de l’Organisation mondiale de la santé et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec, dans la grande majorité des cas, les personnes qui ont subi un TCCL ne présentent plus aucun symptôme après quelques jours ou semaines suivant l’événement traumatique (Mayer et al., 2017 ; Hiploylee et al., 2016 ; Levin & Diaz-Arrastia, 2015 ; McCrea et al., 2009).
Cependant, la littérature scientifique indique que jusqu’à 30 % des personnes ayant subi une commotion cérébrale rapportent des symptômes persistants au-delà de la période habituelle de récupération, un phénomène connu sous le nom de syndrome post-commotionnel (Max et al., 1991 ; Sharp et al., 2014 ; Whitnall et al., 2006 ; Sterr et al., 2006 ; McMillan et al., 2012 ; Voormolen et al., 2018 ; 2019 ; Permenter et Sherman, 2020).
Un rapport du National Center for Injury Prevention and Control (États-Unis) souligne que :
- 30 % des personnes ayant subi un TCCL présentent des déficits cognitifs à long terme.
- 20 % sont incapables de reprendre leur travail.
Dans certains cas, les symptômes incluent :
- Maux de tête chroniques.
- Troubles de la mémoire et de la concentration.
- Fatigue persistante.
- Troubles du sommeil.
- Symptômes dépressifs ou anxieux.
De nombreuses études démontrent qu’un TCCL peut occasionner des déficits cognitifs persistants perturbant les fonctions exécutives, incluant l’inhibition, la flexibilité, la planification et la mémoire à long terme (Wammes et al., 2017 ; Broadway et al., 2019 ; McAllister et al., 1999 ; McAllister et al., 2001 ; Sterr et al., 2006 ; Dean et Sterr, 2013 ; Xiong et al., 2016 ; Broadway et al., 2019 ; Holiday et al., 2020 ; Kunker et al., 2020 ; Sorg et al., 2021).
Les dommages microstructuraux et leur impact
Des études combinant évaluation cognitive et techniques d’imagerie cérébrale (IRM structurale, diffusion du tenseur, spectroscopie) montrent des anomalies microstructurales, métaboliques et neurophysiologiques chez les patients présentant des déficits persistants après un TCCL.
Deux récentes méta-analyses (Oehr et al., 2017 ; Zhu et al., 2019) révèlent que le TCCL endommage les neurofilaments des cellules cérébrales, provoquant des lésions axonales traumatiques. Ces lésions résultent de désalignements, déconnexions et enflures des axones causés par les forces physiques subies lors du traumatisme.
Les études en neuroimagerie montrent également que les dommages microstructuraux touchent les régions impliquées dans les fonctions exécutives, notamment le cortex frontal et les réseaux de connectivité cérébrale (Grossman et al., 2013 ; Xiong et al., 2016 ; Sorg et al., 2014 ; 2021).
De plus, les anomalies dans le thalamus et le cortex frontal médian sont associées à une grande fatigabilité ressentie par les patients présentant des déficits persistants après un TCCL (Nordin et al., 2016).
Impact sur la qualité de vie
Une étude longitudinale de Hiploylee et al. (2017) réalisée auprès de 80 patients ayant un syndrome post-commotionnel a révélé que :
- 65 % des patients rapportaient des troubles de concentration.
- 45 % des patients présentaient des troubles de mémoire.
Ces patients, évalués plus de trois ans après leur TCCL, n’étaient pas en litige pour une compensation financière et avaient tous réussi une épreuve de validation de l’effort. Malgré cela, leurs symptômes persistaient, entraînant des répercussions significatives sur leur qualité de vie.
Rôle de l’évaluation neuropsychologique
L’évaluation neuropsychologique joue un rôle fondamental dans la prise en charge des personnes présentant un syndrome post-commotionnel, particulièrement lorsque des symptômes persistants nécessitent une documentation objective.
Objectifs de l’évaluation
- Identifier les fonctions cognitives touchées
L’évaluation permet de quantifier les déficits cognitifs liés au TCCL, tels que :- La mémoire (épisodique, à court et long terme).
- L’attention (sélective, divisée).
- Les fonctions exécutives (flexibilité, planification, inhibition).
- La vitesse de traitement de l’information.
- Différencier les origines des symptômes
Certains symptômes peuvent être amplifiés ou provoqués par des facteurs non neurologiques, tels que :- L’anxiété ou la dépression.
- Le stress post-traumatique.
L’évaluation aide à établir une distinction entre ces éléments et les impacts directs de la commotion.
- Documenter objectivement les symptômes pour les besoins médico-légaux
Dans les contextes d’assurance ou de litiges, il est souvent crucial de fournir une évaluation scientifique et rigoureuse des déficits persistants. Les rapports neuropsychologiques sont des outils essentiels dans ces situations. - Orienter les interventions
Les résultats permettent de concevoir un plan d’intervention adapté, incluant :- Des stratégies compensatoires pour gérer les déficits cognitifs.
- Des ajustements scolaires ou professionnels (p. ex., horaires adaptés, outils numériques).
- Un programme de réhabilitation cognitive spécifique.
- Suivre l’évolution des symptômes
Des évaluations répétées permettent de mesurer les progrès et d’ajuster les interventions en fonction de l’amélioration ou de la persistance des symptômes.
Mythes courants
- “Il faut perdre connaissance pour avoir une commotion” : Faux. La plupart des commotions n’entraînent pas de perte de conscience. En fait, seulement 10 à 20 % des cas impliquent un évanouissement. Les symptômes peuvent se manifester de manière subtile, comme des étourdissements ou des maux de tête.
- “Si les examens d’imagerie sont normaux, tout va bien” : Faux. Les examens comme le scanner ou l’IRM standard ne détectent généralement pas les perturbations fonctionnelles associées aux commotions cérébrales. Ces techniques ne sont pas conçues pour révéler les anomalies microstructurales ou métaboliques, qui peuvent pourtant être à l’origine des symptômes persistants.
- “Il faut avoir eu un coup direct à la tête pour avoir une commotion cérébrale” : Faux. Une commotion peut survenir en l’absence d’un impact direct à la tête. Des secousses violentes du corps ou un coup sur une autre partie peuvent provoquer une accélération ou décélération rapide du cerveau à l’intérieur du crâne, causant des dommages axonaux diffus.
- “Les symptômes doivent apparaître immédiatement après l’incident pour avoir une commotion” : Faux. Bien que dans la majorité des cas, les symptômes apparaissent immédiatement, environ 20 % des personnes peuvent voir leurs symptômes se développer progressivement sur plusieurs heures, jusqu’à environ 24 heures après l’incident. Cela souligne l’importance d’une surveillance continue après un événement traumatique.
Ressources et soutien
Pour en savoir plus ou obtenir de l’aide, consultez votre médecin, un neuropsychologue ou des cliniques spécialisées dans les traumatismes crâniens. Un soutien adapté peut faire toute la différence dans la récupération.