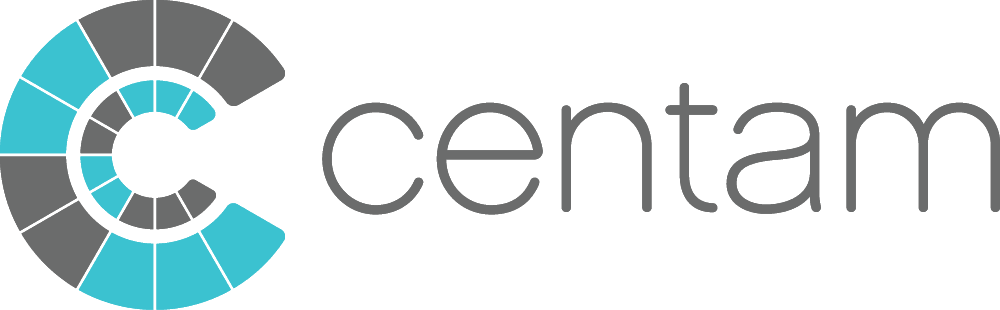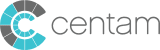L’évaluation neuropsychologique des troubles d’apprentissage
Comprendre les troubles spécifiques d’apprentissage
Les troubles d’apprentissage ne sont pas dus à un manque d’intelligence, à un manque d’effort ou à une mauvaise volonté. Ce sont des difficultés persistantes qui concernent l’acquisition et l’utilisation des habiletés scolaires de base, malgré un enseignement adéquat et un environnement familial stimulant.
Le DSM-5-TR définit les troubles spécifiques d’apprentissage sous trois formes principales :
- Trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture (DSM-5-TR 315.00) – souvent appelé dyslexie. Il touche la précision, la fluidité ou la compréhension en lecture.
- Trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l’expression écrite, notamment l’orthographe (DSM-5-TR 315.2) – souvent appelé dysorthographie. Il se manifeste par des difficultés à écrire sans erreurs, à mémoriser les mots, à respecter les règles orthographiques.
- Trouble spécifique des apprentissages avec déficit en mathématiques (DSM-5-TR 315.1) – souvent appelé dyscalculie. Il concerne la compréhension des nombres, les calculs, la résolution de problèmes ou la mémorisation des faits arithmétiques.
Ces troubles peuvent apparaître seuls ou en combinaison. Chaque personne présente un profil unique : deux enfants avec une dyslexie peuvent avoir des forces et des défis très différents.
La coexistence fréquente avec d’autres troubles
L’une des principales raisons de réaliser une évaluation neuropsychologique complète est la fréquence élevée de troubles associés. On estime par exemple qu’environ 50 % des enfants avec une dyslexie présentent aussi un TDAH. D’autres conditions sont également fréquentes :
- trouble développemental du langage
- troubles anxieux ou de l’humeur;
- difficultés de régulation émotionnelle.
Un trouble développemental du langage peut nuire à la compréhension des consignes et influencer la mémoire verbale, ce qui complexifie le diagnostic des troubles d’apprentissage associés.
L’évolution selon l’âge
Les troubles d’apprentissage se manifestent différemment à chaque étape du développement :
- Petite enfance : lenteur à apprendre les lettres et les sons, difficulté à mémoriser les comptines, confusion persistante des chiffres.
- Âge scolaire primaire : difficultés marquées à lire couramment, à orthographier correctement ou à apprendre les tables de multiplication.
- Adolescence : lenteur, fatigue cognitive, difficultés lors des examens, baisse de motivation.
- Âge adulte : impact sur les études supérieures, les exigences professionnelles et la confiance en soi.
Cette évolution souligne l’importance d’évaluer tôt, mais aussi de réévaluer au besoin à des moments clés (transition vers le secondaire, études supérieures, insertion professionnelle).
Pourquoi une évaluation en neuropsychologie?
Une évaluation en neuropsychologie ne se limite pas à mesurer la lecture, l’orthographe ou les mathématiques. Elle vise à comprendre l’ensemble des processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage. Plusieurs facteurs peuvent imiter ou amplifier des difficultés scolaires :
- un trouble de l’attention;
- un trouble de mémoire de travail;
- un problème visuo-moteur ou graphomoteur;
- une anxiété de performance;
- une faible estime de soi.
Sans une évaluation complète, on risque de passer à côté de la vraie cause ou de ne pas voir que plusieurs difficultés s’entrecroisent.
La démarche d’évaluation
L’évaluation neuropsychologique d’un trouble d’apprentissage dure généralement environ six heures, réparties sur une ou deux journées. Ce temps inclut l’entrevue clinique, l’administration des tests et l’analyse des résultats. Le processus comprend plusieurs étapes.
1. Entrevue clinique
Elle permet de retracer l’histoire développementale, scolaire et médicale. Les parents (ou la personne elle-même, si elle est adulte) partagent les préoccupations et les observations quotidiennes. Ce moment aide à cibler les hypothèses et à contextualiser les résultats.
2. Évaluation cognitive générale
On mesure les capacités intellectuelles de base : raisonnement, compréhension verbale, traitement de l’information, abstraction. Cela permet de situer les apprentissages scolaires par rapport au potentiel cognitif global.
3. Fonctions perceptivo-motrices et visuospatiales
On évalue la coordination œil-main, la graphomotricité, l’organisation visuospatiale. Ces habiletés influencent la qualité de l’écriture, la géométrie et même certaines stratégies de lecture.
4. Attention et fonctions exécutives
On explore la concentration, l’inhibition, la planification, la flexibilité mentale et la mémoire de travail. Ces processus de haut niveau orchestrent l’apprentissage et la résolution de problèmes.
5. Mémoire
On distingue la mémoire à court terme, la mémoire de travail (souvent incluse dans les fonctions exécutives) et la mémoire à long terme. Une difficulté de mémoire peut expliquer des erreurs en lecture, en orthographe ou en calcul.
6. Habiletés scolaires
L’évaluation académique est détaillée :
- Lecture : précision, fluidité, compréhension, vitesse.
- Orthographe : dictée, mémoire orthographique, règles phonologiques, rédaction.
- Mathématiques : numération, calcul, automatisation des faits arithmétiques, résolution de problèmes.
On examine aussi les précurseurs (ex. conscience phonologique, sens du nombre) pour comprendre l’origine des difficultés.
7. Profil psychoaffectif
Les aspects émotionnels sont essentiels. Beaucoup d’enfants avec un trouble d’apprentissage développent une anxiété de performance ou une baisse de l’estime de soi. Ignorer ces dimensions risque de compromettre l’efficacité des interventions.
Diagnostics différentiels et précision clinique
L’analyse complète permet de distinguer :
- un trouble spécifique d’apprentissage réel;
- des difficultés scolaires liées à un autre trouble (TDAH, trouble anxieux, trouble développemental du langage);
- une combinaison des deux.
Cette précision évite les malentendus, par exemple attribuer un retard scolaire uniquement à un trouble d’apprentissage alors qu’il est aggravé par un déficit d’attention non détecté.
Communication des résultats
Environ trois semaines après les tests, une rencontre de rétroaction est prévue. Le neuropsychologue présente le portrait global en langage clair :
- les forces cognitives et scolaires;
- les défis spécifiques;
- les impacts émotionnels possibles;
- les diagnostics retenus, comme une dyscalculie, une dyslexie, une dysorthographie ou un trouble développemental du langage, et leur signification.
Un rapport détaillé est remis. Il comprend :
- un résumé du profil cognitif;
- un plan d’intervention individualisé;
- des recommandations pour l’école (adaptations pédagogiques, stratégies d’étude, aménagements aux examens);
- des suggestions de suivis complémentaires (orthophonie, orthopédagogie, psychologie, ergothérapie).
Ce que l’évaluation apporte
L’évaluation neuropsychologique des troubles d’apprentissage permet de :
- comprendre la cause réelle des difficultés;
- identifier les forces sur lesquelles s’appuyer;
- proposer des interventions ciblées et efficaces;
- soutenir la motivation et la confiance en soi;
- donner aux parents, enseignants et professionnels une feuille de route claire.
Elle ne se limite pas à poser un diagnostic : elle oriente vers une prise en charge adaptée, qui reconnaît l’unicité de chaque profil. Cela peut inclure un suivi ciblé pour la dyslexie, la dyscalculie ou encore le syndrome de Gilles de la Tourette lorsqu’il est présent.
Une vision à long terme
Enfin, l’évaluation ne représente pas une fin en soi, mais un point de départ. Elle offre un portrait de la personne au moment présent et guide les interventions. Toutefois, le développement est dynamique. Un suivi peut être nécessaire à certains moments-clés : entrée au secondaire, choix d’orientation, passage aux études supérieures.
Conclusion
Les troubles d’apprentissage sont fréquents et peuvent avoir un impact important sur le parcours scolaire et la confiance en soi. L’évaluation neuropsychologique, par sa rigueur et son approche globale, permet de distinguer les causes, de comprendre le profil unique de chaque personne et de proposer des interventions adaptées. Elle constitue une étape essentielle pour transformer des difficultés scolaires en une trajectoire d’apprentissage mieux soutenue et plus épanouissante.