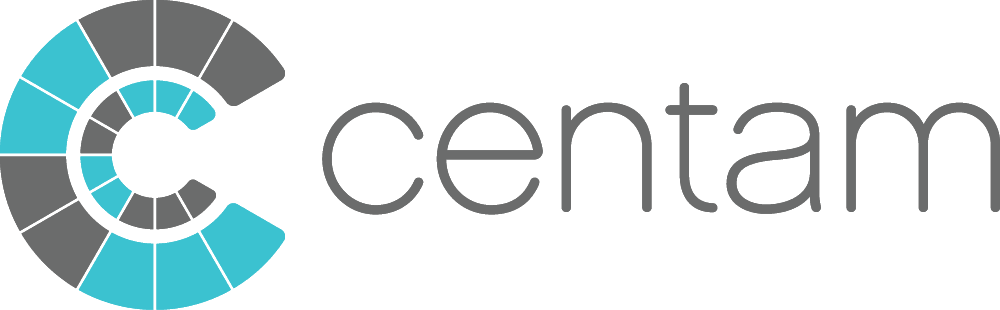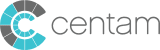Évaluation du trouble du spectre de l’autisme
Cette démarche d’évaluation du TSA vise à comprendre le profil global de la personne pour établir un diagnostic juste et nuancé.
Qu’est-ce que l’évaluation du trouble du spectre de l’autisme
Une démarche d’évaluation adaptée en neuropsychologie permet d’identifier les signes probants du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de déterminer si l’enfant ou l’adulte satisfait aux critères diagnostiques du DSM-5-TR.
Une évaluation TSA repose sur une analyse approfondie du fonctionnement social, communicationnel et comportemental.
- L’évaluation du trouble du spectre de l’autisme est avant tout une démarche clinique.
- Il n’existe pas de “test unique” pour diagnostiquer le TSA.
- L’évaluation doit tenir compte de l’âge, du sexe, du contexte culturel et des comorbidités.
- La collaboration avec la famille est essentielle.
L’évaluation du TSA se fait à l’aide d’un entretien clinique et d’outils cliniques standardisés. Elle comprend quatre volets principaux :
1. Évaluation des comportements associés au trouble du spectre de l’autisme
Cette évaluation se fait à l’aide de grilles d’évaluation cliniques validées et standardisées. Elle prend en compte les comportements observés par les parents, les enseignants ou d’autres intervenants (par exemple, les éducateurs). Lorsqu’on évalue le trouble du spectre de l’autisme chez un adulte, on se réfère aux parents, au conjoint ou à d’autres proches pour évaluer les comportements dans le quotidien.
Cette étape constitue un volet essentiel de l’évaluation TSA, tant pour les enfants que pour les adultes.
2. Évaluation des comportements associés au TSA :
- Comportements non verbaux : Contact visuel, expressions faciales, gestes, posture, etc.
- Communication verbale : Langage expressif et réceptif, pragmatique, prosodie, etc.
- Interactions sociales : Capacité à initier et maintenir des interactions, compréhension des émotions, etc.
- Intérêts et activités : Intensité et nature des intérêts restreints, stéréotypies motrices, etc.
L’analyse de ces comportements structurés permet de soutenir l’évaluation TSA avec des indicateurs cliniques précis.
3. Évaluation clinique de la reconnaissance et de l’interprétation des émotions ainsi que de la cognition, la perception et le jugement social :
Cette évaluation permet d’analyser les habiletés nécessaires pour comprendre, décrire et se représenter les états mentaux des autres, et d’utiliser ces représentations pour expliquer ou prédire leur comportement.
Exemples :
- Reconnaître et comprendre le point de vue, les pensées et les intentions des autres.
- Identifier l’émotion qu’une personne peut ressentir dans une situation donnée.
- Compréhension des règles sociales et résolution de problèmes liées à des situations de socialisation.
Ces éléments occupent une place déterminante dans une évaluation TSA, particulièrement pour identifier les profils dits plus subtils.
4. Évaluation du profil neuropsychologique, incluant la signature cognitive typiquement retrouvée dans le trouble du spectre de l’autisme.
L’évaluation permet également d’éliminer d’autres diagnostics possibles qui pourraient expliquer les symptômes (par exemple, déficience intellectuelle, trouble du langage, trouble anxieux, trouble de la personnalité chez l’adulte, etc.).
Enfin, l’objectif de l’évaluation du TSA n’est pas simplement d’identifier les caractéristiques centrales du trouble, mais aussi de découvrir les caractéristiques uniques, les intérêts et les capacités de l’individu.
À Centam, nous choisissons de ne pas nous appuyer sur l’ADOS-II pour diagnostiquer le trouble du spectre de l’autisme (TSA). Bien que largement utilisé, cet instrument présente plusieurs limites importantes qui affectent sa validité et sa fiabilité :
- Cadre conceptuel dépassé : L’ADOS-II a été développé à partir des concepts du DSM-IV (1994), qui ne reflètent plus les définitions actualisées du TSA dans le DSM-5-TR (2013 ; 2022).
- Critères diagnostiques dépassés : Le système de cotation de l’ADOS-II repose sur les critères du DSM-IV-TR (2000), qui ne reflètent plus les définitions actualisées du TSA dans le DSM-5-TR (2013 ; 2022).
- Risque de surdiagnostic : Des études récentes montrent des taux de faux positifs allant jusqu’à 29–34 %, ce qui signifie que de nombreuses personnes peuvent être faussement diagnostiquées comme autistes avec l’ADOS-II (Green et al., 2022 ; Hong et al., 2022).
- Cas manqués dans certains profils : Les adultes, les femmes et les personnes qui développent de fortes stratégies de compensation (camouflage) obtiennent souvent des scores sous les seuils diagnostiques, bien qu’elles répondent aux critères dans la vie quotidienne (Lai et al., 2015).
- Biais de genre : La recherche montre une sensibilité réduite chez les femmes, qui peuvent présenter des signes différents ou plus subtils (Ratto et al., 2018).
- Effets des comorbidités : Des troubles psychiatriques comme l’anxiété, la psychose ou les troubles du langage peuvent gonfler les scores à l’ADOS-II, entraînant une confusion avec le TSA (Havdahl et al., 2016).
- Validité écologique limitée : Comme l’ADOS-II est administré dans un contexte structuré et artificiel, il ne reflète pas toujours la manière dont les comportements se manifestent dans les environnements naturels comme la maison, l’école ou le travail (Maddox et al., 2017).
- Biais culturel et linguistique : Des études ont soulevé des inquiétudes quant au fait que les normes et les matériels de l’ADOS-II ne sont pas suffisamment adaptés à des contextes culturels et linguistiques variés, ce qui limite sa validité en dehors des échantillons de standardisation initiaux (Kalb et al., 2022).
- Manque de stabilité et de constance dans le temps : Les résultats de l’ADOS-II peuvent varier selon l’évaluateur et le moment de passation. En d’autres termes, deux évaluateurs différents peuvent ne pas arriver aux mêmes conclusions pour une même personne, ou une personne peut obtenir des résultats différents si elle est testée de nouveau quelques semaines plus tard. Ce manque de constance crée de l’incertitude et augmente le risque d’un diagnostic erroné (McCrimmon & Rostad, 2014).
- Non suffisant à lui seul : Même les concepteurs de l’ADOS-II insistent sur le fait qu’il ne doit pas être utilisé comme unique outil diagnostique (Lord et al., 2012).
- Coût et charge supplémentaires : L’utilisation de l’ADOS-II exige une séance d’évaluation supplémentaire. Cela augmente presque du double le coût de l’évaluation et oblige la personne (et souvent sa famille) à consacrer une journée additionnelle à l’évaluation, ce qui peut être fatigant et stressant.
À la place, nous basons nos évaluations sur des démarches cliniques sensibles et validées, appuyées par des recherches récentes (Barbaresi et al., 2022, JAMA Pediatrics). Ces méthodes nous permettent non seulement de respecter les normes scientifiques les plus élevées, mais aussi de tenir compte du profil unique, des forces et des défis de chaque individu — ce qu’aucun test isolé ne peut accomplir.